 |
| Biosynthèse de l'acide aminé Sélénocystéine (Sec) sur son ARN de transfert (ARNtSec). Le sélénium est à la fois un polluant toxique et un oligo-élément essentiel, qui entre dans la composition de la sélénocystéine: le 21ème acide aminé. (...). Source iconographique et légendaire: http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article574 |
Le sélénium est un composant des sélénoprotéines, qui possèdent une large palette d'effets pléiotropiques, allant des effets anti-oxydants et anti-inflammatoires à la production d'hormone thyroïdienne active. Dans les dix dernière années, la découverte de pathologies associées au polymorphisme des gènes codant pour le sélénoprotéines a attiré l'attention sur les effets des sélénoprotéines sur la santé. Un taux bas en sélénium a été associé à un risque de mortalité augmenté, des fonctions immunitaires affaiblies et un déclin cognitif. Un niveau plus élevé en sélénium ou une supplémentation en sélénium provoque des effets antiviraux, est essentielle à une reproduction optimale chez l'homme et la femme, et réduit le risque de maladie thyroïdienne autoimmune. Des études prospectives ont montré le bénéfice d'un taux en sélénium élevé sur les risques de cancer de la prostate, du poumon, du côlon et de la vessie; mais les résultats des essais mis ensemble ont aussi fait surgir l'hypothèse qu'une supplémentation en sélénium n'est nécessaire que si le régime alimentaire est inadéquat. La supplémentation chez les personnes dont l'apport en sélénium est déjà adéquat, peut leur faire augmenter le risque de diabète de type 2.
Le point crucial sur lequel il faut insister, pour ce qui est des effets du sélénium sur la santé, est l'inextricable lien en forme de U du profil sélénium des personnes: alors que le sélénium en supplémentation sera bénéfique aux personnes au profil sélénium bas, les sujets au profil sélénium déjà adéquat ou élevé pourraient subir les effets délétaires d'un apport supplémentaire en sélénium. Prof Margaret P Rayman DPhil, in The Lancet, Early Online Publication, 29 February 2012
Source: http://www.thelancet.com/ / Traduction et adaptation: NZ

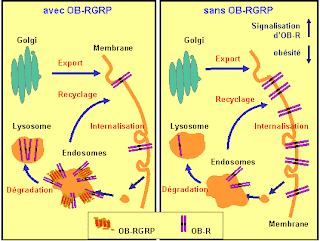






.jpeg)









