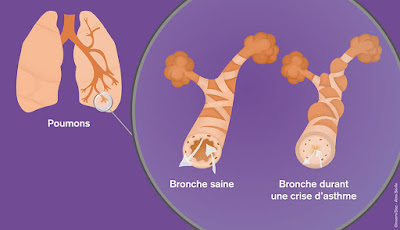|
Effet du tabagisme sur la fonction respiratoire d'après le site TabacNet. VEMS = Volume Expiratoire Maximum Seconde
Source: http://www.oncoprof.net/Generale2000/g02_Prevention/Index/Index_pr07.inc.php |
De nombreuses questions se posent quant à l’innocuité neuropsychiatrique
des médicaments indiqués dans la cessation du tabagisme, à savoir varenicline et
bupropion. Leur efficacité par rapport au patch de nicotine repose
principalement sur des comparaisons indirectes, et il n’y a que peu d’information
disponible relative à l’innocuité et l’efficacité chez les fumeurs atteints de
troubles psychiatriques. Nous avons comparé le risque sécuritaire et l’efficacité
de la varenicline et du bupropion avec le patch de nicotine et le placebo chez
des fumeurs avec ou sans troubles psychiatriques.
Nous avons effectué un essai randomisé en double aveugle, triple placebo,
contrôlé par placebo et par produit actif (patch de nicotine ; 21 mg par
jour) de varenicline (1 mg deux fois par jour) et bupropion (150 mg deux fois
par jour) pendant 12 semaines avec 12 semaines de suivi sans traitement
effectué dans 140 centres (centres d’études cliniques, cliniques
hospitalo-universitaires, et cliniques de jour) situés dans 16 pays entre le 30
novembre 2011 et le 13 janvier 2015. Les participants étaient des fumeurs
déterminés à abandonner le tabagisme, avec ou sans troubles psychiatriques, et
qui participaient à une brève séance de conseil à la cessation du tabagisme à
chaque visite. La randomisation était générée par ordinateur (1:1:1:1). Ni les
participants, ni les investigateurs, ni le personnel de recherche n’avaient accès
au tableau d’attribution des traitements. Le critère principal d’évaluation
était l’incidence (résultante de mesure de plusieurs évènements indésirables modérés
et sévères). Le critère principal d’évaluation de l’efficacité des traitements
était une abstinence confirmée biochimiquement, durant les semaines 9 à 12.
Tous les participants répartis de manière aléatoire étaient inclus dans l’analyse
d’efficacité et ceux qui recevaient le traitement étaient inclus dans l’analyse
de sécurité. (…).
8 144 participants ont été répartis de manière aléatoire, 4 116 ont
été inclus dans la cohorte psychiatrique (4 074 d’entre eux ont été inclus
dans l’analyse d’innocuité) et 4 028 dans la cohorte non-psychiatrique (3 984
d’entre eux ont été inclus dans l’analyse d’innocuité). Dans la cohorte non
psychiatrique, 13 (1.3%) participants sur les 990 ont rapporté des évènements
indésirables neuropsychiatriques modérés et graves dans le groupe varenicline, 22 (2.2%)
participants sur les 989 dans le groupe bupropion, 25 participants (2.5%) sur les 1 006
dans le groupe patch de nicotine, et 24 participants (2.4%) sur 999 dans le
groupe placebo. Les différences de risque (DRs) varenicline-placebo et
bupropion-placebo relatives aux évènements indésirables neuropsychiatriques
modérés et graves étaient de -1.28 (Intervalle de Confiance -IC- 95% de -2.40 à
-0.15) et de -0.08 (de -1.37 à 1.21), respectivement ; les DRs des
comparaisons avec le patch de nicotine était de -1.07 (de -2.21 à 0.08) et 0.13
(de -1.19 à 1.45), respectivement.
Dans la cohorte psychiatrique, des
évènements indésirables neuropsychiatriques modérés et sévères ont été rapportés
chez 67 (6.5%) des 1026 participants du groupe varenicline, 68 (6.7%) des 1 017 participants du groupe bupropion, 53 (5.2%) des 1016 participants du groupe
patch de nicotine, et 50 (4.9%) des 1 015 participants du groupe placebo.
Les DRs des comparaisons varenicline-placebo et bupropion-placebo étaient de
1.59 (IC 95% de -0.42 à 3.59) et de 1.78 (de -0.24 à 3.81), respectivement ;
les DRs versus le patch de nicotine étaient de 1.22 (de -0.81 à 3.25) et de
1.42 (de -0.63 à 3.46), respectivement.
Les participants du groupe recevant la
varenicline ont atteint des taux d’abstinence plus élevés que ceux sous placebo
(odds ratio [OR] 3.61, IC 95% de 3.07 à 4.24), patch de nicotine (1.68, de 1.46
à 1.43) et bupropion (1.75, de 1.52 à 2.01). Les participants sous bupropion et
patch de nicotine ont atteint des taux d’abstinence plus élevés que ceux sous
placebo (OR 2.07 [de 1.75 à 2.45] et 2.15 [de 1.82 à 2.54], respectivement). Entre
cohortes, les évènements indésirables les plus fréquents par groupe de
traitement étaient nausée (varenicline, 25% [511 sur 2 016 participants]),
insomnie (bupropion, 12% [245 sur 2 006 participants]), rêves anormaux
(patch de nicotine, 12% [251 sur 2 022 participants]), et maux de tête
(placebo, 10% [199 sur 2 014 participants]). La comparaison de l’efficacité
du traitement n’a pas présenté de différence entre les cohortes.
Cette étude n’a pas montré d’accroissement significatif en évènements indésirables
imputables à la varenecline ou le pupropion concernant le patch de nicotine ou
le placebo. La varencicline s’est révélée plus efficace que le placebo pour ce
qui est de l’aide apportée aux fumeurs pour atteindre l’abstinence, alors que
le bupropion et le patch de nicotine se sont montrés plus efficaces que le
placebo. Prof Robert M Anthenelli MD, et al, dans The Lancet, publication en
ligne en avant-première, 22 avril 2016
Financement : Pfizer et GlaxoSmithKline
Source : The Lancet /
Traduction et adaptation : NZ